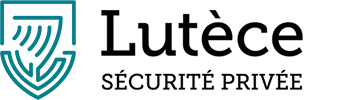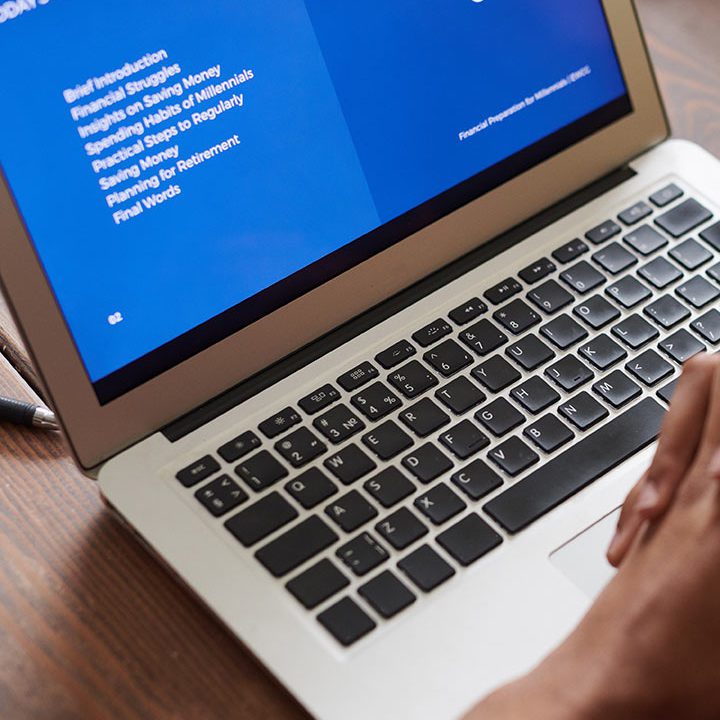En raison du nombre de personnes qui s’y rendent chaque jour, et de la quantité de biens à surveiller, les magasins de grande distribution nécessitent eux aussi la présence d’agents de sécurité. La protection des personnes La protection des personnes est essentielle pour assurer la sécurité générale du magasin. passe notamment par une surveillance globale […]
Les mariages font partie de ces évènements privés qui rassemblent un grand nombre de personnes. Dans certains cas, il sera donc préférable de faire appel à une société de sécurité spécialisée. Le besoin de sécurité pour un mariage, comme pour tout autre évènement privé, sera principalement dépendant de deux paramètres : le nombre de personnes […]
Les soirées étudiantes sont des événements incontournables. Elles représentent des temps forts attendus par la plupart des étudiants qui, le temps d’une soirée, apprécient de se retrouver entre eux pour faire la fête. L’organisation de ce type de soirées est le plus souvent prise en charge par l’association étudiante de l’école, or cela ne s’improvise […]
S’il est fréquent pour une entreprise d’avoir recours à une entreprise de sécurité, on oublie parfois qu’il est tout à fait possible pour un particulier d’en bénéficier. Lutèce Sécurité Privée vous présente ainsi les principaux services auxquels les particuliers peuvent faire appel pour assurer leur sécurité. La protection rapprochée pour les particuliers Les agents de […]
Quel est le rôle d’un agent rondier ? Les rondiers intervenants sont des agents de sécurité qui effectuent des rondes de surveillance sur un site donné pour le compte de leur client. Par définition, ils doivent être mobiles et peuvent réaliser ces rondes à pied ou en véhicule, banalisé ou non, selon le site sur lequel […]
De nombreux cambriolages ont encore eu lieu cette année dans les bijouteries et galeries d’art, notamment à Paris. Il est devenu indispensable d’investir dans des moyens techniques et humains pour lutter contre ces vols. Quels outils pour protéger une bijouterie ou une galerie d’art ? Les vitrines cloches et autres protections en verre blindé sont d’usage […]
A Paris, les magasins subissent fréquemment des vols et actes de malveillance. En conséquence, tout magasin doit mettre en place des actions de lutte contre ces comportements. Lutèce Sécurité Privée vous explique pourquoi et comment protéger au mieux votre magasin à Paris. Pourquoi protéger son magasin ? Lutter contre la démarque inconnue Les vols représentent la […]
Pourquoi recourir à un agent cynophile ? Les chiens sont très utiles dans les entreprises de sécurité privée, car ils possèdent des aptitudes innées qui viennent compléter celles de l’Homme, et qui en font des partenaires de choix. Spontanément, on pense en premier lieu à leur capacité de détection sans faille. C’est typiquement le genre […]
Le président de la République dévoile les étapes de son plan de déconfinement. Commerces, lieux de culture et terrasses des bars et restaurants doivent rouvrir le 19 mai L’agenda des réouvertures
Le gardiennage de nuit en région parisienne Nécessaire à certains types d’établissements, le gardiennage de nuit vise à assurer la sécurité des personnes et des biens en toutes circonstances. Tous types d’agents peuvent assurer le gardiennage de nuit : il peuvent être agents cynophiles, agents SSIAP, agents rondiers… Cela dépendra principalement du type de lieu […]